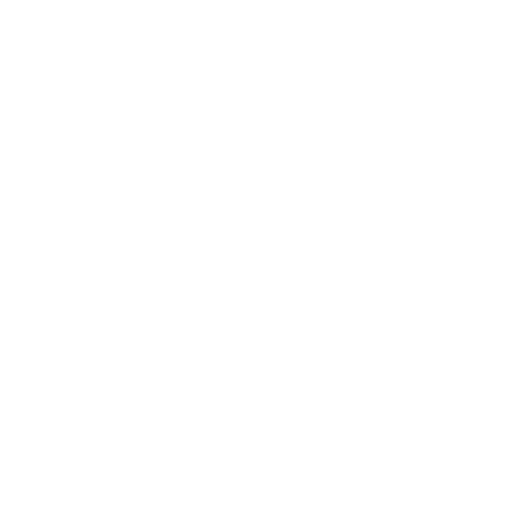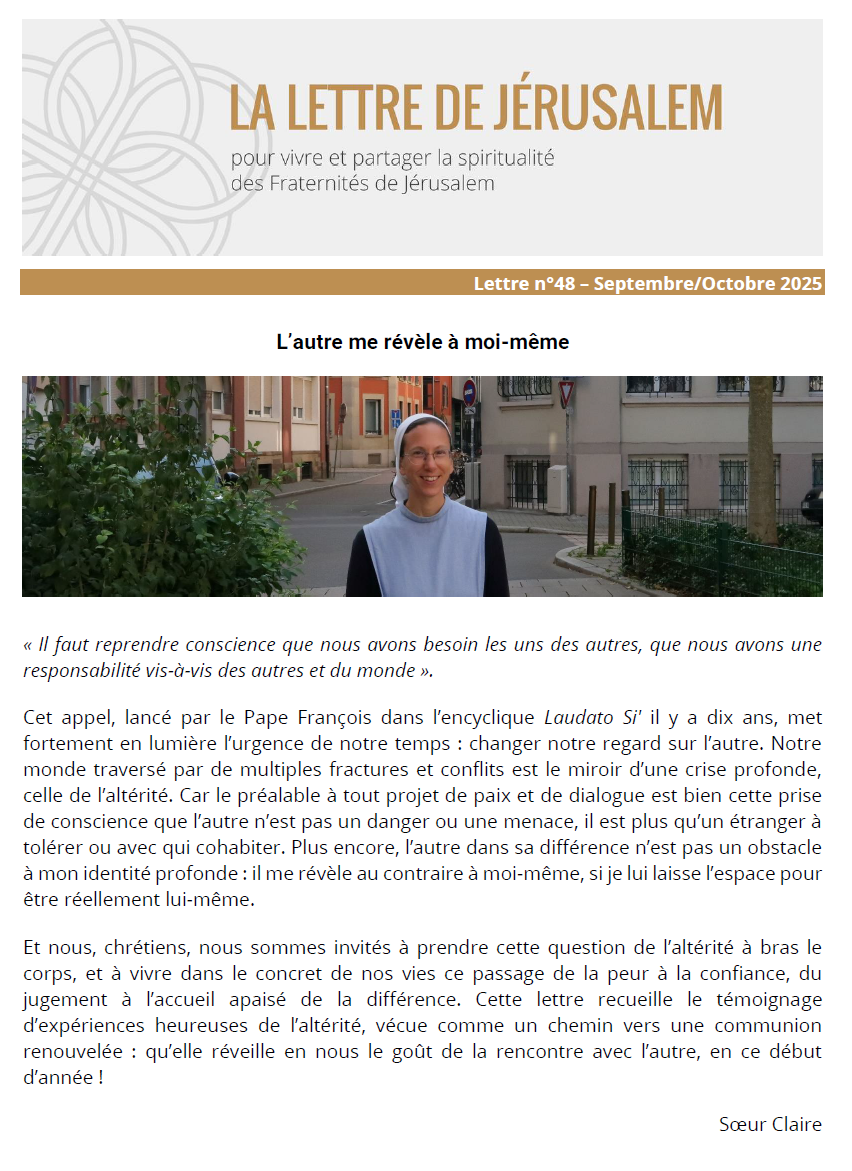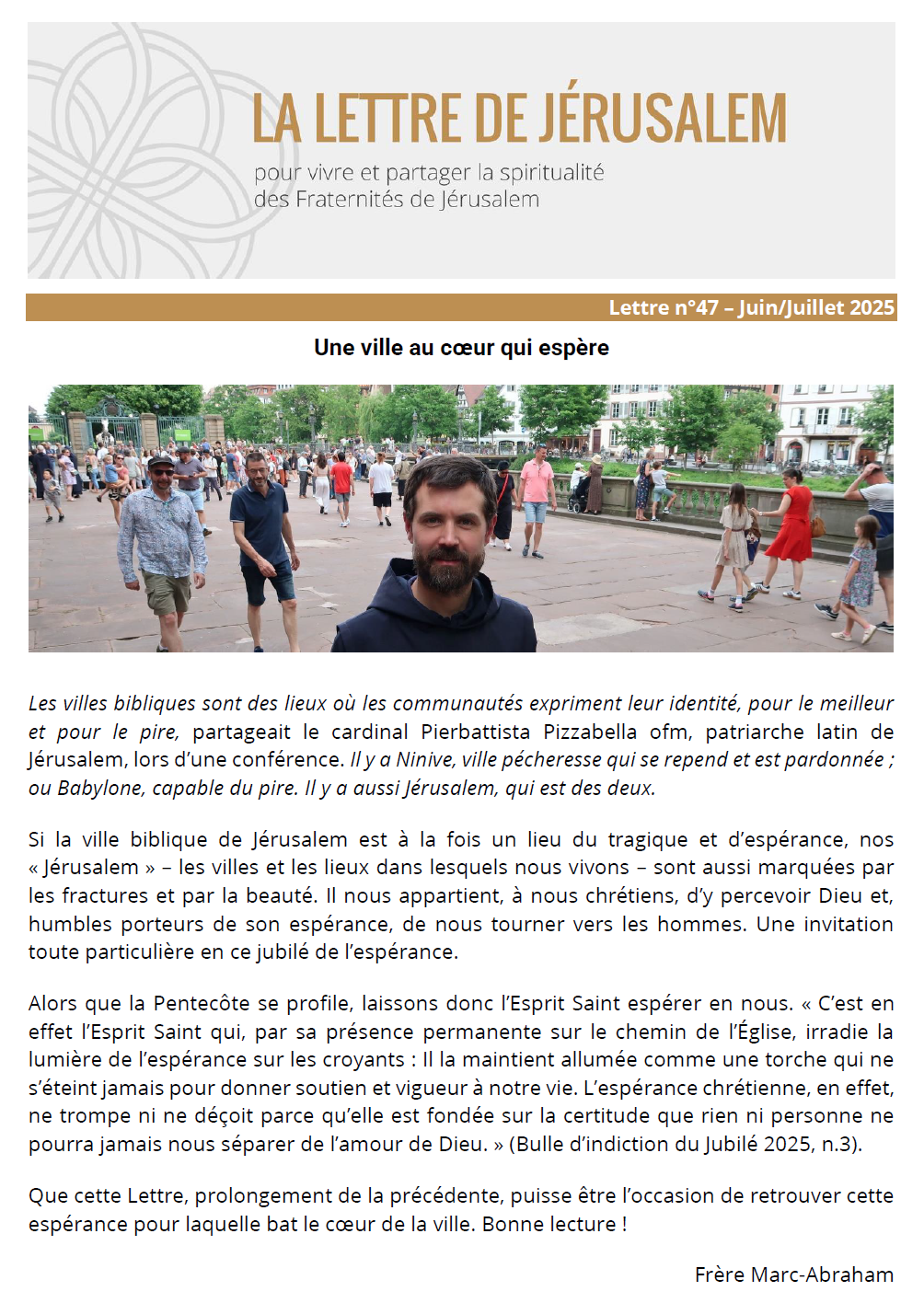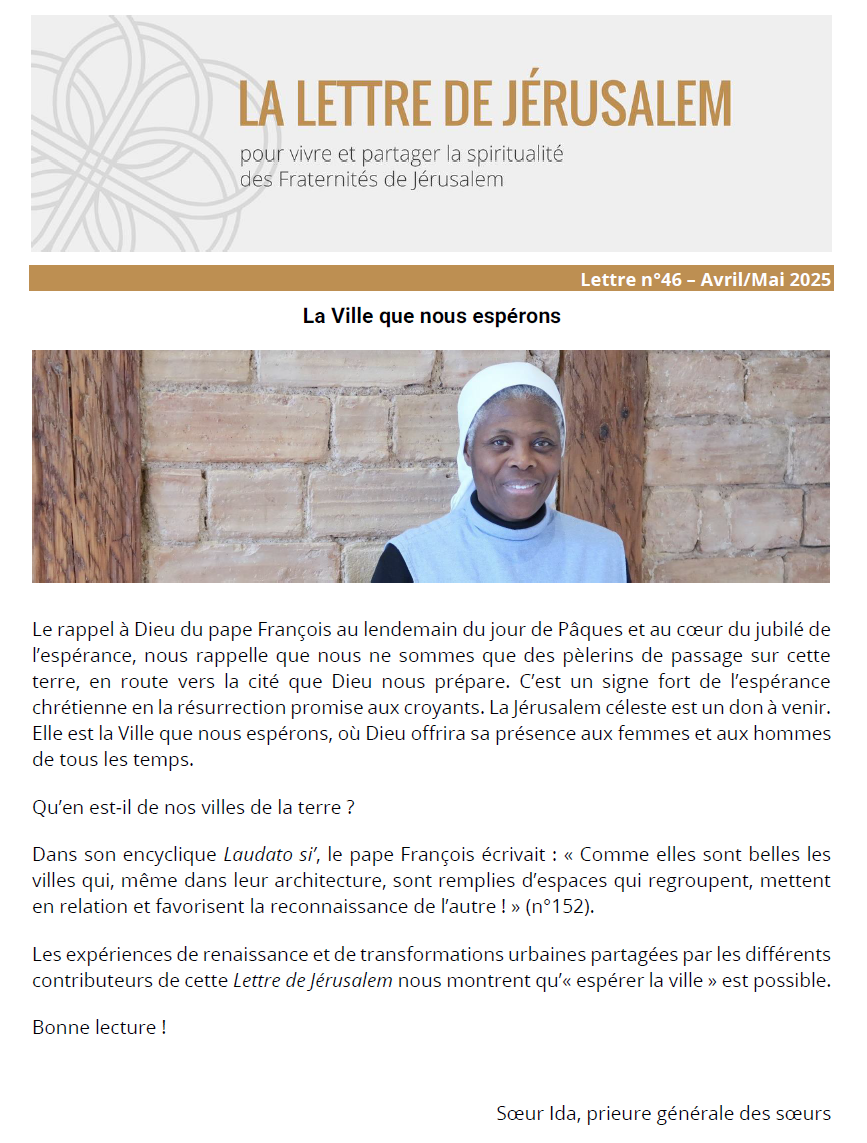Une relecture de l’expérience vécue au sein du chantier sur la communion entre frères et sœurs.

Le paradoxe de la distance, en ce qui concerne les relations humaines, est bien connu…
A un extrême, une distance trop grande fait de l’autre un étranger, et met en péril la relation ; mais à l’autre extrémité, une distance trop faible pose également problème, car elle aboutit à la fusion, ce qui n’est qu’une caricature de la relation. La relation vraie, saine, implique le jeu de deux libertés qui assument leur altérité ; tout un équilibre est sans cesse à trouver et à retrouver, entre saine distance et juste proximité.
Ce qui sera peut-être un peu moins banal, c’est de réaliser que cela peut se vérifier également au niveau collectif, entre deux communautés ; et c’est bien l’expérience que nos deux instituts des frères et des sœurs de Jérusalem ont faite au cours de ces derniers mois, dans le travail de réforme.
Pour s’en convaincre, que l’on prenne l’évolution de nos Constitutions respectives – et du lien qui existe entre elles -. Nos premières Constitutions (1996) étaient pratiquement identiques, chez les sœurs et chez les frères. La seule différence entre les deux textes concernait la question du sacerdoce ordonné, qui s’applique aux frères. Des Constitutions “jumelles”, pourrait-on dire. Oui, mais des jumelles “étrangement aveugles”, qui curieusement s’ignoraient l’une l’autre…chacune ne faisant dans son texte pas de mention de l’autre institut. Le fait est que, pendant longtemps, le lien entre les deux instituts a été peu réfléchi, peu formulé. Frères et sœurs, nous priions ensemble la liturgie, nous collaborions pour telle ou telle mission, nous avions des temps gratuits en commun, par exemple aux grandes fêtes. Peut-être qu’alors, tout ce que notre communion recèle de potentialités n’était pas bien identifié ; on s’enrichit peu en regardant son reflet dans le miroir !
Et ce n’est pas exagéré de dire qu’il y avait sans doute des craintes, et des attentes, des deux côtés : les sœurs se sentaient plus attentives peut-être au lien de communion ; les frères, en recherche d’une plus juste altérité.
Nous avons prié le Christ ressuscité, lui qui renouvelle le don de la fraternité universelle. Et nous avons creusé la question de la communion entre frères et sœurs, en cherchant les mots justes pour l’exprimer. Par exemple, celui de “réciprocité”, de préférence à celui de complémentarité. Parce que l’un, dans sa différence, ne viendra jamais vraiment combler les manques de l’autre. Mais si elle est mise en relation, cette différence peut être, par grâce, générative d’un surcroît de vie. C’est l’expérience que nous avons faite, dans notre cheminement entre nos deux instituts ces derniers mois. La différence n’est pas un obstacle à la relation, au contraire. Souvent, la crainte naît de ce qui est insuffisamment formulé.
Essayer de “se dire”, en face de l’autre, et écouter l’autre “se dire”, cela permet “à vrai dire” de lever bien des obstacles. Nous repartons de nos assemblées générales de cet été 2025, de ce fait, avec des projets de Constitutions différenciées, tâchant d’exprimer ce qu’est la vocation des frères de Jérusalem d’une part, des sœurs de Jérusalem d’autre part. L’exprimer au plus juste, avec nos mots d’aujourd’hui. Sans surprise, ces mots ne sont pas les mêmes, côté hommes et côté femmes, et c’est heureux ! Cependant ces Constitutions distinctes contiennent aussi des paragraphes communs, exprimant comment nous comprenons notre communion frères-sœurs, et ce que nous vivons des échanges, des collaborations et dans la liturgie. Ces paragraphes communs, au terme de tout un parcours d’écriture partagée, ont reçu l’approbation des frères comme celle des sœurs – ce qui est au fond la plus forte expression de notre communion que nous puissions espérer !…
Sœur Maylis (Fraternité de Magdala)