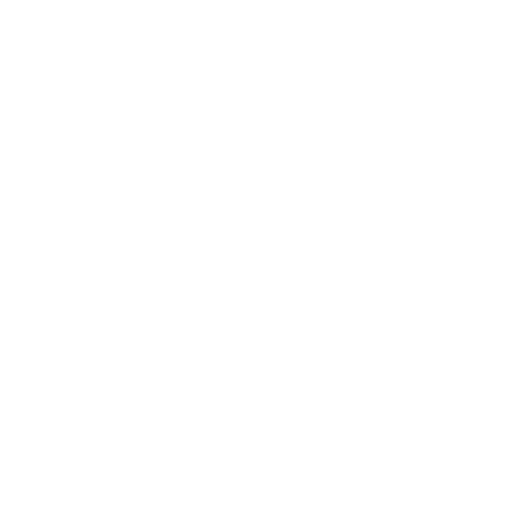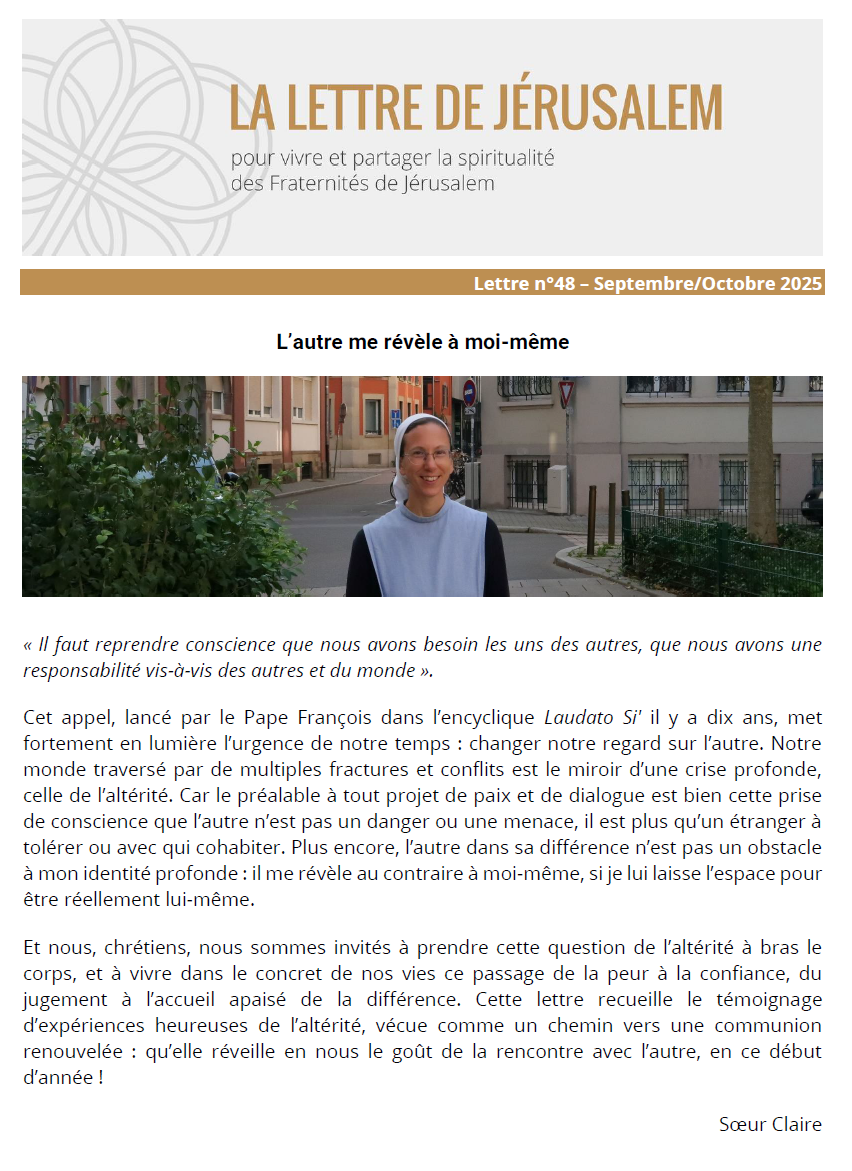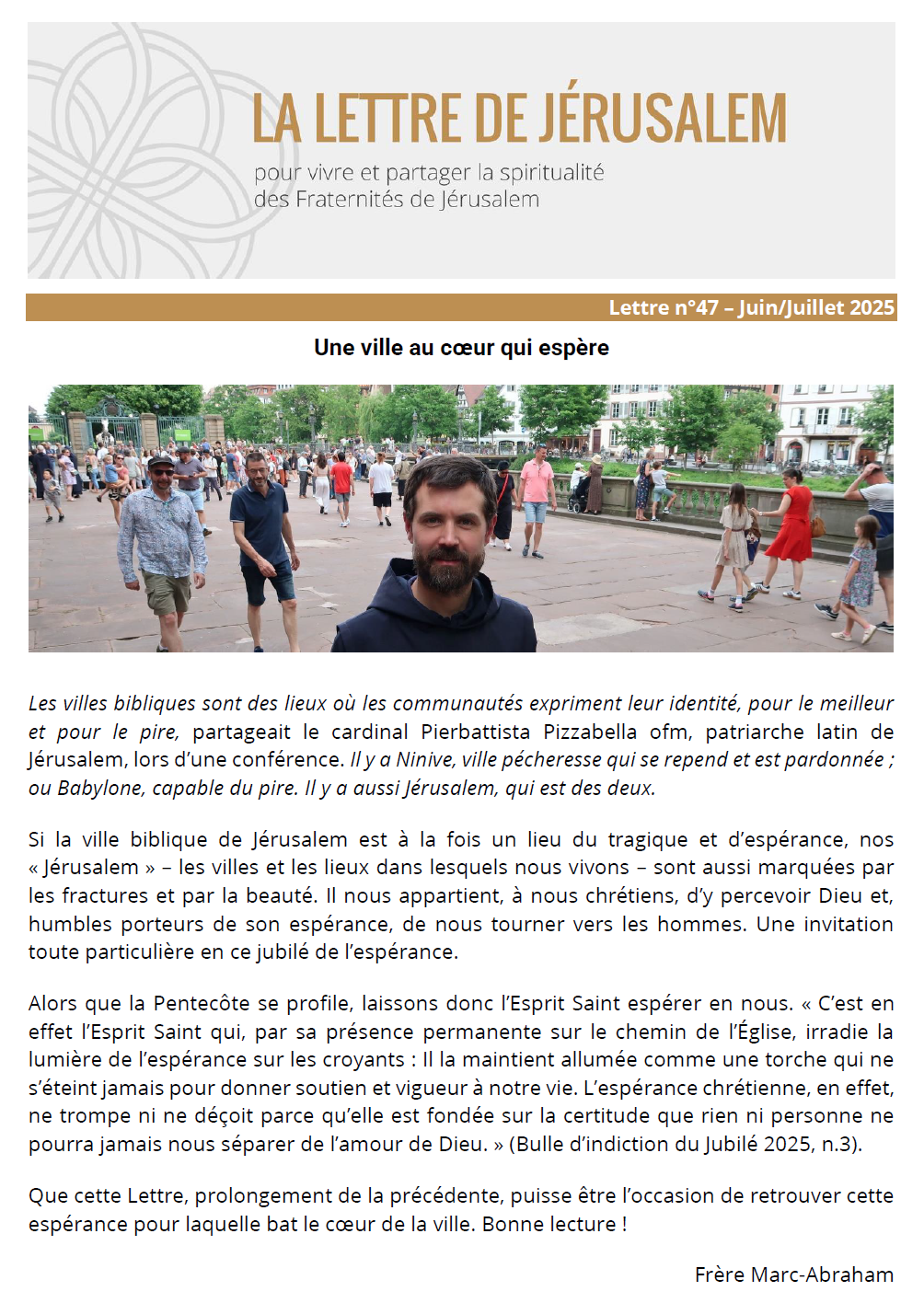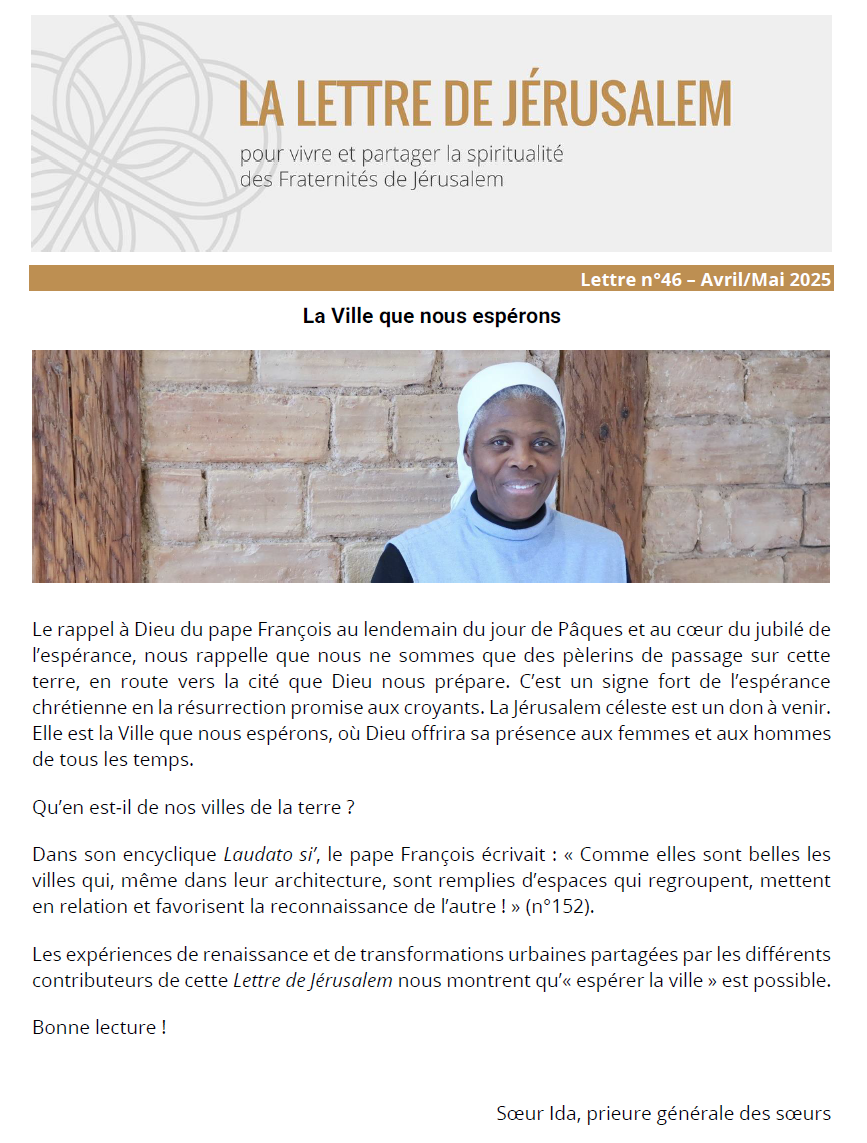Qui parmi nous n’a pas un jour été ému par la beauté du chant liturgique ? Il suffit de l’entendre faire vibrer les pierres de la parole de Dieu, tirée tantôt du psautier, tantôt du riche patrimoine liturgique des hymnes, répons et autres richesses. C’est en même temps le cœur de l’homme qui se livre et fait entendre ses battements lorsqu’il s’accorde à ses frères et sœurs de chœur pour s’ajuster dans le rythme et la polyphonie.

L’explication est anthropologique : la voix de l’homme est pour lui l’instrument de musique le plus immédiat, le plus complet, le plus subtil qui soit. Dès lors, le chant lui ouvre un espace aux multiples dimensions qui le met en communion avec l’Église entière. Il découvre à l’homme sa dimension laudative : en faisant déborder la parole de son enveloppe illocutoire, le chant liturgique devient acte de louange. Il lui découvre aussi sa dynamique théologale : par l’écoute réciproque qu’il suppose et par l’effort d’harmonisation et de synchronisation qu’il exige, le chant choral est pour l’homme acte d’offrande pour le chœur, la communauté, et in fine l’Église, le forçant du même coup à se libérer de ses propres aspérités égocentriques pour se rendre audible et crédible.
Ces intuitions avaient mobilisé nos frères et sœurs aînés soucieux de réconcilier le peuple de Dieu avec la liturgie. On était alors au lendemain du Concile, il fallait en recevoir et mettre en application les fruits – époque héroïque de fondations multiples. L’Église, pour sa part, nous rappelle, dans ses livres liturgiques, sa prédilection pour l’Office chanté. Il vaut la peine de rouvrir les notes préliminaires du Bréviaire, et de remarquer, dans ce sens, comme elles mettent en évidence un lien de connaturalité entre l’action liturgique avec ses dimensions laudative et communautaire, et le génie du chant choral qui édifie la communauté :

La plupart des actions liturgiques sont d’un genre lyrique, et par conséquent ne peuvent exprimer tout leur sens qu’avec le chant ; c’est surtout le cas pour les psaumes, les cantiques, les hymnes et les répons.
Dans la célébration de la Liturgie des heures, le chant ne peut donc être tenu pour un ornement surajouté comme du dehors à la prière ; bien plutôt il jaillit des profondeurs de l’âme qui prie et qui loue Dieu, et il manifeste pleinement et parfaitement la nature communautaire du culte chrétien.
(Présentation Générale de la Liturgie des Heures, 269-270).
D’après le texte, le chant n’est donc ni annexe, ni accessoire, mais il est constitutif de la liturgie.
Dans cette veine, le texte accorde en son chapitre III une importance centrale à la psalmodie. Celle-ci constitue une modalité en soi du chant à l’intérieur de l’Office. Plusieurs modes de cantilation peuvent être appliqués et sont pratiqués selon les communautés. Il s’agit en général d’une alternance des versets entre deux parties de l’assemblée : deux chœurs égaux disposés en vis à vis, ou un groupe hommes d’une part et un groupe de femmes d’autre part, un petit chœur d’une part et l’assemblée d’autre part, ou encore à l’unisson d’une part et en polyphonie d’autre part (cf. Présentation Générale de la Liturgie des Heures, 122). Cette alternance s’accorde au rythme des flux biologiques qui traversent l’existence humaine : inspires et expires, systoles et diastoles, écoute et prise de parole, signes d’échanges vitaux entre l’homme et son monde extérieur. L’individu ne se suffit pas à lui-même, il a besoin de recevoir pour donner, de s’unir aux autres pour réaliser sa propre nature en Dieu. Le chant alterné des psaumes manifeste aussi la progression de l’homme qui, un pas après l’autre, s’achemine vers son achèvement, dans l’élan de toute une tradition inaugurée par le peuple biblique. Comme une épiphanie de ce pèlerinage terrestre, le chant des psaumes scande la marche de l’humanité tendue vers sa fin.
Le chant de l’Office édifie l’Homme nouveau de l’Église, il réalise son unité. En ces temps où la crise touche les vocations sacerdotales, il y aurait là une piste à retenir pour envisager la liturgie des heures dans le prolongement de la liturgie eucharistique. En effet, si le fruit de l’Eucharistie (la res tantum des médiévaux) est la transformation des fidèles en un seul Corps du Christ (« Humblement nous te demandons qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit en un seul corps », Prière Eucharistique II), l’Église ne comprend-elle pas ici, dans le chant de la liturgie des heures et de manière plus éminente dans celui des psaumes, un moyen spécifique d’édifier ce Corps du Christ ? Alors, si la beauté du chant liturgique nous atteint, ne serait-ce pas parce qu’elle atteste de l’unité de cet Homme nouveau : n’en serait-elle pas la manifestation ultime ?
Frère Victor-Marie (Fraternité du Mont Saint-Michel)